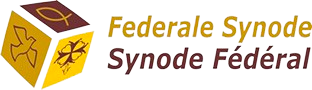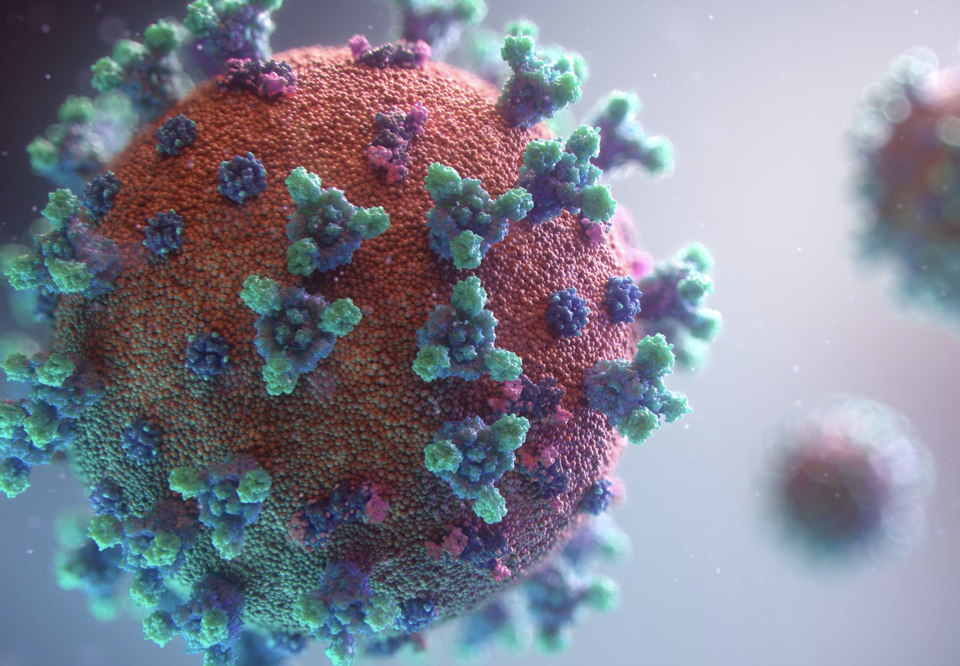Déclaration sur l’abattage rituel(11/05/2017)
11 mai 2017
Une éducation chrétienne(AS 24/11/2018)
24 novembre 2018Téléchargez le texte officiel à ce sujet
ARGUMENTAIRE POUR LE MAINTIEN DU COURS DE RELIGION DANS L’HORAIRE OBLIGATOIRE DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
Les cultes reconnus en Belgique demandent le maintien d’un cours de religion intégré dans l’horaire obligatoire des élèves de l’enseignement officiel. Cette demande se base sur 3 éléments fondamentaux :
– Les enjeux de l’éducation religieuse à l’école
– Le respect de la volonté des parents
– Le respect de la Constitution
1. Les enjeux de l’éducation religieuse à l’école
● Travailler les questions de sens en ouvrant les élèves à la dimension religieuse.
L’école joue un rôle irremplaçable dans la construction de la personnalité de l’enfant et du jeune sous tous ses aspects. Et dans cette construction, la spécificité d’un cours de religion est d’accompagner les élèves dans leur recherche de sens en les ouvrant à la dimension religieuse vis-à-vis de laquelle il permet à chacun d’apprendre à se situer personnellement. Pour être crédible et satisfaire aux exigences liées à toutes les disciplines scolaires, un tel cours doit être donné par une personne mandatée et formée par des institutions académiques reconnues, qui connaît la religion concernée de l’intérieur et respecte la liberté de conviction des élèves.
● Construire le vivre ensemble.
Le cours de religion contribue utilement à construire la citoyenneté, le vivre ensemble, le « construire ensemble ». Cela est d’ailleurs explicitement prévu dans les référentiels des cours de religion des différents cultes. La pratique du dialogue interconvictionnel vise à apprendre aux élèves, par l’organisation d’activités communes, à se forger une identité personnelle, dans l’ouverture bienveillante et la compréhension d’autres manières de penser et de vivre. Lieux de questionnement, de recherche et de découvertes, avec un maximum de convivence, ces activités deviennent des laboratoires de citoyenneté où se rencontrent des personnes, où se brassent des idées et des cultures, où se croisent des regards pluriels qui honorent la richesse des différences et évitent des cloisons qui séparent. La pratique du dialogue interconvictionnel permet aux élèves de rencontrer l’autre en vérité en dépassant jugements et préjugés, sans renier pour autant ses convictions » (Référentiel commun de compétences du cours de religion 2017). Pour favoriser ce dialogue, il importe de connaître sa culture, son héritage, ses Ecritures fondatrices.
● Travailler le dialogue entre culture et religion.
Paul Ricœur souligne que « toute religion s’incarne dans l’épaisseur des modes de pensée et de vie qui définissent chaque culture » (Histoire et vérité, Le Seuil). Les cultures et les religions sont indissociablement liées.
Par ailleurs, Olivier Roy ajoute que « la crise des religions, visible à travers la poussée des fondamentalismes, vient d’une disjonction croissante entre religion et culture(s). Le religieux demeure pour ainsi dire isolé, sorti des cultures traditionnelles où il est né, écarté des nouvelles cultures où il est censé s’intégrer. De cette schizophrénie naissent la plupart des phénomènes religieux déviants qu’on peut observer aujourd’hui » (O. Roy, « La sainte ignorance. Le temps des religions sans cultures », éditions du Seuil, 2008). Un des enjeux du cours de religion sera précisément de travailler, de manière rationnelle et critique, le dialogue entre culture et religion. Ce faisant, d’apprendre aux jeunes à identifier et rejeter, dans certaines expressions du religieux, les dérives extrémistes et toute forme d’abus de pouvoir.
2. Le respect de la volonté des parents
On sait que les parents qui le souhaitent peuvent demander que leur enfant soit dispensé du cours de religion ou de morale. Et les chiffres sont éloquents : entre 80 et 90 % des parents des élèves de l’enseignement officiel ne demandent pas cette dispense et inscrivent explicitement leur enfant à un cours de religion ou de morale. Il y a là un signe citoyen qu’il ne faut certainement pas négliger. (Voir tableaux des chiffres en annexe 1.)
Un cours de religion qui est ainsi soutenu par un tel nombre de parents n’est pas un cours d’histoire des religions ni de sociologie ou de psychologie des religions. Dans ces démarches-là, le religieux est pris comme un objet extérieur à l’élève. La question religieuse – dont l’actualité montre combien elle reste tellement importante aujourd’hui – n’est pas alors considérée comme une question spécifique mais comme l’objet d’un autre questionnement (historique, psychologique, sociologique, …) qui ne fait pas droit à l’apport spécifique d’un éclairage religieux. Les éclairages apportés par un professeur de religion formé – et cette formation est désormais exigée par le décret « Titres et Fonctions » – ont et auront, auprès des élèves, un crédit que n’obtiendra jamais une approche externe et externalisée des questions religieuses…
En plus de la liberté de choix garantie par la Constitution, l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques, et l’article 18, §4, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, proclament la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. (Voir les deux citations en annexe 2.)
3. Le respect de la Constitution
L’article 24 de la Constitution est très clair sur le fait qu’un choix doit être proposé aux élèves. L’alinéa 4 de son premier paragraphe stipule que : « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ». Et l’alinéa 2 de son paragraphe 3 dit : « Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse ». Cela confirme que ce cours est lié à l’obligation scolaire et fait donc partie de la grillehoraire. Par ailleurs, la note explicative du Gouvernement auprès du Sénat (doc. 25 mai 1988 p. 4 et 83) dit ceci : « Tous les jeunes soumis à la scolarité à temps plein ou à temps partiel ont droit à l’éducation morale ou religieuse, à charge de la Communauté, et donc dans le cadre de la grille-horaire ». Plus tard, lors d’une audition au Parlement de la FWB en mars 2013, le constitutionnaliste H. DUMONT a répondu à la question de savoir si le législateur décrétal pourrait rendre, le cas échéant, ces cours facultatifs pour ces élèves. Dans le long raisonnement juridique qu’il a développé, il a rappelé un élément du rapport de la Commission de la Chambre chargée de la révision de la Constitution et des Réformes Institutionnelles : « Finalement, à la Chambre, il y eut un consensus pour considérer qu’il serait inconcevable que les cours de morale et de religion deviennent facultatifs. Il doit y avoir obligation de les suivre sauf dérogation individuelle et motivée ».
Plus avant dans son raisonnement, le Professeur Dumont dit encore ceci : « Rendre le cours facultatif malgré la volonté contraire du pouvoir constituant (…) doit être écarté (…). Le constituant belge a décidé qu’en principe l’éducation des jeunes citoyens postule la participation à un cours dédié à l’examen des questions liées à la recherche de sens de la vie et aux questions éthiques, à partir soit d’un point de vue religieux, soit d’un point de vue laïque. Cette position de principe doit être respectée. Mais il faut tout autant permettre aux parents qui se réclament d’une religion non reconnue ou qui ne se reconnaissent ni dans une religion ni dans la morale inspirée par le libre examen d’échapper au dilemme dans lequel le principe constitutionnel les enferme ». C’est la question de la dispense, déjà abordée par le Conseil d’Etat « Sluys » n°25.326 du 14 mai 1985. Cet arrêt permettait de dispenser du cours de morale ou de religion un élève dont les parents pratiquent une religion non reconnue. Ce droit a été réaffirmé par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 mars 2015.
Invité à répondre à la question de la réduction du nombre d’heures consacrées aux cours philosophiques, le Professeur Dumont montre clairement que la réduction de ces cours de 2h à 1h ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel, mais il ajoute immédiatement : « Cette réduction ne peut cependant pas avoir pour effet que ces cours soient à ce point appauvris que l’obligation prévue à l’article 24 §1 alinéa 4 de la Constitution ne soit correctement respectée. En vertu de l’article 24 § 5 de la Constitution, c’est au législateur décrétal lui-même qu’il appartient de fixer le volume horaire minimal. On ne voit pas bien comment il pourrait descendre en dessous d’1h par semaine ». Tous ces éléments donnent à croire que décider de rendre le cours de religion/morale optionnel, ou le sortir de la grille-horaire, ferait qu’il ne concernerait plus TOUS les élèves soumis à l’obligation scolaire, et cette décision serait donc en contradiction avec la Constitution.
En conclusion
C’est pour toutes ces raisons que les cultes reconnus en Belgique demandent le maintien d’un cours de religion intégré dans l’horaire obligatoire des élèves et des modalités pertinentes pour que l’organisation de ce cours retrouve une situation, à la fois constructive et apaisée.
Les signataires :
– Cardinal Josef De Kesel et Mgr Guy Harpigny (Pour le culte catholique)
– Pasteur S. Fuite et Docteur G. Lorein (Pour le culte protestant et évangélique)
– Métropolite Athénagoras (Pour le culte orthodoxe)
– Mr Ph. Markiewicz et Mr le Grand Rabin Guigui (Pour le culte israélite)
– Mr Salah Echallaoui (Pour l’Exécutif des musulmans de Belgique)