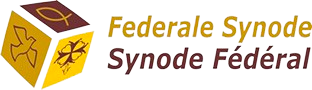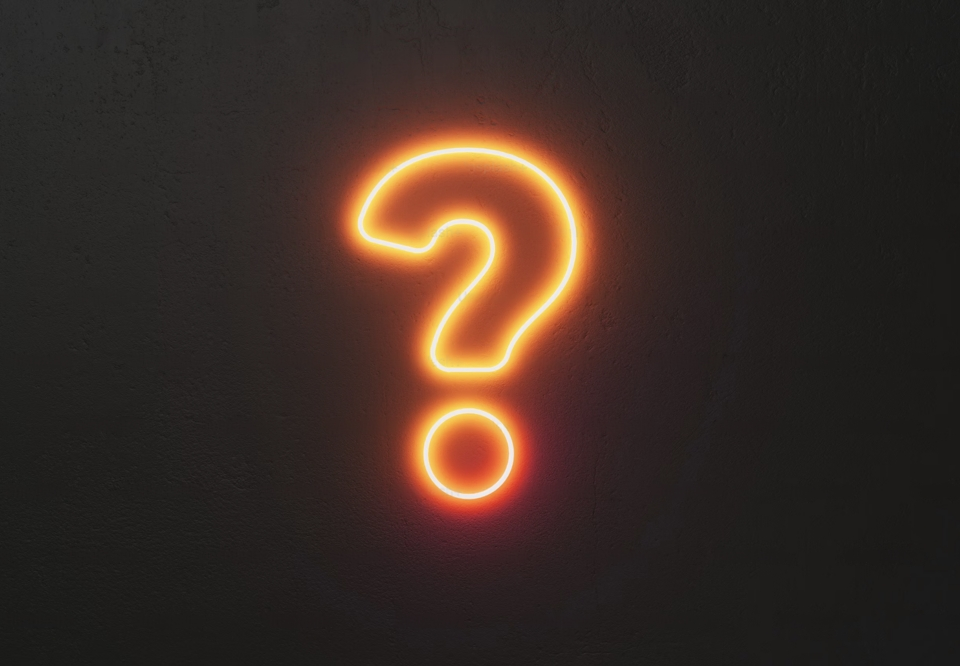Euthanasie(AS 14/06/2014)
14 juin 2014
Le chrétien et la société(AS 22/11/2014)
22 novembre 2014Téléchargez le texte officiel à ce sujet
1. Homosexualité et relations homosexuelles
A. Homosexualité dans l’Église et la société
Au sein des églises, il y a des divergences d’opinion au sujet de l’homosexualité. Cela va de pair avec les développements de la société. Depuis les années 60, la sexualité est reliée à l’expérience du bonheur et du plaisir plutôt qu’à la reproduction. Sa place au sein des relations humaines n’est plus nécessairement vue comme un engagement à un amour durable et à la fidélité. Elle n’est plus vue sous l’angle de l’éthique. Quand l’Église la présente encore ainsi, cela suscite de la méfiance. C’est partiellement compréhensible à la lumière de l’hypocrisie et des abus perpétrés au sein de l’Église. Le regard sur les relations sexuelles entre personnes du même sexe a également changé profondément. Les autorités facilitent et stimulent celles-ci au moyen de leur législation, ce qui a fortement contribué à l’émancipation des personnes homosexuelles. Le mouvement homo ne combat pas seulement la discrimination contre les personnes homosexuelles, mais se bat aussi contre les conceptions éthiques traditionnelles, surtout quand elles sont basées sur la Bible. Ces évolutions n’échappent pas aux églises. On ne voit plus les choses de la même façon, ce qui allait de soi ne va plus de soi, la confusion et la suppression des valeurs créent des tensions. Celles-ci se font notamment ressentir auprès des frères et sœurs homosexuels dans les églises. Plus d’une fois par le passé, ils ont été traités de manière grossière, avec toutes les conséquences qui s’en suivent. Nous voulons partager leur peine. Le seul fait de penser, ou de faire comme s’ils valaient moins que d’autres nous rend coupables devant Dieu. Nier ou relativiser ces choses ne nous aidera pas à avancer. Il nous faut une vraie réflexion. Dans ce contexte, l’Église cherche son appui dans la Parole de Dieu. Celle-ci est la ligne directrice et le critère pour la foi et la vie. La manière de vivre de notre prochain peut être sujet à jugement, mais le prochain lui-même ne peut jamais être le sujet de notre condamnation. Nous nous opposons fermement à toute forme de violence contre les personnes homosexuelles.
B. Terminologie et chiffres
Les sentiments homosexuels désignent les sentiments sexuels pour quelqu’un du même sexe. Selon une enquête parmi la population néerlandaise, ces sentiments apparaissent dans une certaine mesure chez 6% des hommes et 15% des femmes. Lorsque ces sentiments sont permanents, on parle d’une orientation homosexuelle (on parle aussi de ‘préférence’). Les chiffres cités pour ce cas sont les suivants : 3% des hommes et 1% des femmes. Le terme ‘homophilie’ n’est plus employé. Nous préférons aussi éviter l’emploi du mot ‘nature’. Ce mot suggère trop fortement une préférence sexuelle déterminée de manière biologique. Quand quelqu’un se voit et se profile comme une personne homosexuelle, on parlera d’identité homosexuelle. Dans la pratique, cela va en général de pair avec des relations homosexuelles intimes (nous utiliserons aussi les termes ‘acte’ et ‘comportement’).
C. Arrière-plan
Dès l’Antiquité classique, on cherchait à expliquer les sentiments homosexuels, dont l’existence n’était pas ignorée. Dans le débat actuel, la science de la biologie joue un grand rôle. Les explications biologiques mettent l’accent sur le caractère inné de l’orientation homosexuelle (angl. ‘nature’). Il faudrait la chercher dans les hormones, le cerveau, les gènes ou dans une combinaison de ces éléments. Le renvoi à des facteurs psychosociaux est plus ancien. On peut penser au comportement appris et à l’influence de l’environnement (angl. ‘nurture’). Parfois, on suggère qu’il y a eu un problème dans le développement de l’enfant vers l’âge adulte. Comme modèle explicatif, on peut encore citer l’homosexualité comme étant l’expression d’une révolte contre l’ordre établi de la société. Les scientifiques continuent, en ce qui concerne l’origine d’une orientation homosexuelle, de parler d’une interaction complexe entre ‘nature’ et ‘nurture’. On a cherché s’il était possible de changer l’orientation homosexuelle en une orientation hétérosexuelle. En général, quelqu’un qui a une orientation homosexuelle dès son plus jeune âge ne pourra pas (ou guère) la changer. Il en va parfois autrement de quelqu’un qui a développé cette orientation plus tard, dans les dernières années de son adolescence. Quoi qu’il en soit, ni des facteurs physiques, ni des facteurs psychiques, ni encore des facteurs sociétaux ne sont la norme pour nos actions. L’être humain est doué d’une volonté et il est responsable de la façon dont il se comporte, y compris avec son corps. C’est en ayant cela à l’esprit que l’Église professe que la norme pour nos actions est trouvée dans la Parole de Dieu.
D. Notre approche des Écritures
Dans notre interprétation des Écritures l’acceptation par la foi précède les considérations de notre raison : l’Esprit qui a parlé par les prophètes et les apôtres est le même Esprit qui témoigne dans nos cœurs que les Écritures ont été données par Dieu. Elles se prouvent à elles-mêmes, indépendamment de nos argumentations. Nous voulons recevoir la Bible dans l’obéissance de la foi. Nous le faisons avec joie et amour car les Écritures annoncent la bonne nouvelle du pardon et de la libération. L’interprétation évangélique des Écritures tient compte du temps et de la culture d’alors comme de celle d’aujourd’hui, mais sans que la culture prenne le dessus sur la Parole. Car, dans ce cas, nous serions facilement trop critiques par rapport à la culture d’alors et pas assez critiques envers la nôtre. La même Parole s’adresse à l’humanité tout entière. L’explication de la Bible demande une confrontation de l’Écriture avec elle-même. Dans cette démarche, elle tient compte de l’histoire du salut dans sa progression de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament.
Cette progression se voit dans le fil rouge qui va de la création et du péché originel à la rédemption. Culminant à la crucifixion et à la résurrection du Seigneur JésusChrist, cette histoire est celle du Royaume de Dieu. Les croyants reçoivent en Christ la délivrance de la culpabilité et de la puissance du péché. Ils reçoivent en Lui une nouvelle identité. Ils participent ainsi à la nouvelle création, quoiqu’encore en chemin vers cet état de perfection. La vie chrétienne de tous les jours se résume dans l’imitation de Jésus-Christ. Ceci implique porter sa croix, accepter le sacrifice de soi et mener le combat dans la perspective réjouissante du Royaume de Dieu. Dans le cortège de pèlerins, les croyants deviennent des « porteurs de croix » courageux et joyeux.
E. Sexualité et mariage
Dieu a créé l’être humain homme et femme. L’homme et la femme sont égaux dans leur relation avec le Créateur tout en étant différents l’un de l’autre. L’orientation vers l’autre sexe est propre à la sexualité humaine créée par Dieu. L’homme et la femme partagent leur vie dans la joie et transmettent la vie dans leur fécondité. Ce don de la sexualité a cependant subi les conséquences de la chute de l’homme. Le mariage, la sexualité et le don des enfants sont des signes de la bénédiction de Dieu. Dans l’Ancien Testament, autant que dans le Nouveau, la sexualité n’est jamais comprise comme une pulsion pour satisfaire sa propre quête du bonheur. Elle demeure un don à la gloire de Dieu, au service des relations mutuelles dans l’amour, le respect et la fidélité. Elle demeure aussi un don au service de la survie de l’humanité. En tant qu’alliance matrimoniale, le mariage des croyants est un reflet de l’alliance entre Dieu et les hommes, tout comme du lien étroit entre Christ et son Église. Ainsi, les liens du mariage sont noués pour la vie. Ils réunissent deux personnes dans leur être tout entier. Ces liens sont confirmés par une promesse réciproque en présence d’un ou plusieurs témoins. Au sein de cette alliance, le don de la sexualité est de cette manière protégé et y trouve une place appropriée. Le désir mutuel entre l’homme et la femme n’est pas un désir isolé. Il a sa place dans le cadre plus général du désir de l’accomplissement de la plus haute forme de bonheur. Celui-ci est concrétisé dans le lien de l’être humain avec son Sauveur. L’homme et la femme trouvent leur plénitude la plus profonde dans le lien avec Dieu par Christ. La sexualité et le mariage sont à placer, et à relativiser, dans la perspective de la promesse du Nouveau Testament résumée par cette phrase : « Dieu est tout en tous ». Dans ce contexte, le fait d’être célibataire est regardé par le Seigneur Jésus et par Paul comme une alternative équivalente et comme une possibilité de contribuer à la venue du Royaume.
F. Les données bibliques
C’est en vain que nous chercherions les mots ‘homosexualité’ et ‘relations homosexuelles’ dans la Bible. Et là où il est question d’homosexualité, cela ne concerne, à première vue, que le comportement homosexuel. Dans les paragraphes suivants, nous passerons en revue les textes les plus pertinents à ce sujet.
1. Genèse 1 et 2. En partant du fait que la sexualité est un don créationnel à l’homme et à la femme, les sentiments homosexuels et l’orientation homosexuelle doivent être vus comme signes de la rupture à cause de la Chute. Nous souffrons tous de cette rupture d’une manière ou d’une autre. Personne ne peut donc se croire supérieur ou se sentir inférieur.
2. Romains 1.26-27. Dans les premiers chapitres de sa lettre, Paul explique clairement que tous les êtres humains, sans distinction aucune, ne peuvent être sauvés qu’en étant justifiés par la foi en Christ. L’apôtre énonce plus de vingt péchés par lesquels l’homme se rend coupable devant Dieu (Romains 1.29-31). Il ne met pas l’accent sur les rapports sexuels entre personnes du même sexe parce que ce péché serait plus grave que les autres, mais plutôt parce que ce péché rend explicite la nature même du péché : l’adoration par l’homme de la création plutôt que de son Créateur. Ainsi, la pensée de l’homme est assombrie et il sème la confusion dans ses actes. Agir « contre nature » n’est pas ici une action qui s’oppose à la nature actuelle d’une personne. C’est bien plutôt une action qui s’oppose à l’intention du Créateur. On suggère parfois que Paul refuse seulement la prostitution des païens dans leurs temples, ou les relations sexuelles imposées par un maître à son esclave. Mais cela est insuffisant et facilement réfuté. On ne peut pas non plus démontrer que Paul veut seulement refuser un comportement décadent et immoral. Tous les actes homosexuels sont caractérisés par les termes ‘honteux’ et ‘impurs’. Les lecteurs juifs pouvaient reconnaître en ces mots la traduction grecque du livre du Lévitique. Mais ce jugement correspond aussi à celui du monde païen. On n’y pouvait accepter des actes homosexuels entre citoyens libres et égaux, et encore moins une relation homosexuelle. Paul n’écrit pas explicitement au sujet d’une orientation homosexuelle, bien que celle-ci soit connue du monde antique et probablement aussi de lui-même. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a rien à dire là-dessus. Dans Romains 1, Paul écrit justement avec l’idée du lien étroit entre la personne et ses actes. Dans ses actes, on voit à quel point l’homme (tous les êtres humains et chaque être humain) subit les conséquences du péché jusqu’au plus profond de son être.
3. 1 Corinthiens 6.9-10 et 1 Timothée 1.9-10. Les mots ‘dépravés’ et ‘homosexuels’ (traduction de la Colombe) désignent des hommes et garçons qui s’attachent à une manière de vie pécheresse. Celle-ci constitue un barrage à l’entrée dans le Royaume de Dieu. Certains dans l’église de Corinthe se sont tournés vers Dieu et ont trouvé la délivrance de ces choses. Ils vivent à présent par la grâce sous une nouvelle souveraineté, celle de Dieu.
4. Lévitique 18.22 et 20.13. Dans ces chapitres, il est question de commandements contre des péchés qui menaçaient l’avenir du peuple d’Israël dans la terre promise. Tous ces péchés tombent sous le jugement, ils sont une ‘abomination’ aux yeux de Dieu (Lévitique 18.26-30). Cependant, le comportement homosexuel est caractérisé ainsi séparément, sans être regroupé avec d’autres péchés.
L’interdiction y attenant a un aspect cultuel : dans les royaumes païens, il y avait des ‘hommes sacrés’. Mais ces prostitués masculins ne sont pas mentionnés en tant que tels. En outre, le contexte dans lequel figure cette interdiction est d’une portée plus générale. Elle est reliée à un interdit de relations homosexuelles en général, que l’on rencontre également ailleurs dans l’Orient ancien. Le mot
‘abomination’ se rapporte au mélange de choses dissemblables. L’interdiction protège les limites que Dieu a posées dans sa création. Il protège aussi les fondements du « vivre ensemble » humain et ainsi ceux de l’existence du peuple d’Israël. Il souligne aussi le caractère saint du peuple de Dieu au milieu des autres peuples.
5. Genèse 19. À Sodome, l’hospitalité est gravement bafouée. Le viol était une arme pour dépouiller les vaincus de la seule chose qui leur restait : leur dignité masculine. Le jugement de Dieu est sévère, non seulement parce qu’ici la violation de la loi de l’hospitalité est en cause, mais encore parce que cela s’est passé de manière contre nature. En y faisant référence, l’apôtre Jude, lui aussi, rejette implicitement le comportement homosexuel (Jude 7-8). Cependant, la situation de Genèse 19 est si extrême et particulière qu’elle n’est pas applicable lors d’une approche pastorale de frères et sœurs homosexuels qui veulent tenir compte de la volonté de Dieu.
6. Juges 19. Une histoire semblable à la précédente se déroule ici au sein même du peuple d’Israël. De par le choix des mots, il est clair que le viol d’une femme est regardé comme un délit alors que l’intention de viol à l’égard d’un homme est compris comme une infamie. Dans cette histoire aussi, l’affection entre personnes du même sexe ne joue aucun rôle.
G. Textes bibliques et actualité
À travers les siècles, l’Église chrétienne a refusé toute relation homosexuelle. Mais on ne peut se contenter de citer quelques versets bibliques. Ceux-ci doivent être pondérés. Une interdiction biblique dans la culture d’alors vaut-elle toujours aussi pleinement dans la nôtre ? Certaines dispositions légales de l’Ancien Testament semblent déjà ne plus être valables dans le Nouveau Testament. Comment les Écritures sur ce point, devraient-elles être lues ? La Bible (re)connaît-elle l’orientation homosexuelle ? L’orientation homosexuelle est un signe de rupture parce qu’il lui manque l’orientation vers l’autre sexe, prévue par le Créateur. Au sein d’une relation homosexuelle, il manque la diversité propre à la création, nécessaire pour se compléter mutuellement en tant qu’êtres humains. Il manque aussi la possibilité de procréer, propre à la création. D’ailleurs, tout être humain ressent la rupture causée
par le péché originel, que ce soit dans ce domaine ou dans d’autres.
Dans son amour insondable, Dieu a prévu un moyen de restauration, par l’alliance avec Abraham et sa descendance. Dieu fait venir son Royaume par Christ. Les trésors que le Roi distribue sont le pardon des péchés, la libération de la justification de soi et de l’orgueil, mais aussi des puissances qui font de nous leurs esclaves. En soi, la libération en Christ pourrait aussi conduire à une réparation des dégâts dans le domaine de l’orientation sexuelle. Cependant, il faut se rappeler que le salut ‘déjà’ reçu n’est ‘pas encore’ devenu entièrement réalité. Mais les croyants en Christ ont déjà reçu une nouvelle identité. Cela les amène à se charger de leur croix selon le modèle de leur Seigneur, dans l’obéissance à la Parole de Dieu. Dans le combat que cela engendre, la puissance du Saint-Esprit leur est promise. Mais Paul était-il vraiment au courant de la profonde interrelation existant entre l’orientation homosexuelle et la personnalité humaine dans sa totalité ? S’il avait su ce que nous en savons aujourd’hui, n’aurait-il pas été plus modéré dans son jugement ? Dans l’Antiquité grecque, une relation entre deux citoyens adultes du même sexe n’était pas acceptée. Par contre, une relation entre un homme adulte et un garçon l’était. On était aussi au courant de la notion d’une orientation homosexuelle innée. Il en est parlé chez certains philosophes grecs comme chez certains auteurs romains. Ces mentions datent tout autant de la période antérieure, que de celle directement postérieure à l’époque de Paul. C’est pourquoi on peut supposer que Paul a eu connaissance de l’existence d’une préférence sexuelle qui n’est pas nécessairement le fruit d’un choix personnel. Dans son jugement d’actes homosexuels, exprimé dans ses lettres aux Romains et aux Corinthiens – inspirées par le Saint-Esprit –, cela ne joue néanmoins aucun rôle. De nos jours, l’individualité et l’authenticité demandent d’avoir droit de cité pour vivre des sentiments que l’on considère comme faisant partie du plus profond de l’être humain. En comparaison des temps bibliques, c’est quelque chose de nouveau. Mais nous sommes convaincus que les paroles des auteurs de la Bible ont un sens qui fait autorité et qui dépasse leur propre temps et contexte. Le refus du comportement homosexuel ne peut pas non plus être relativisé selon une lecture des Écritures inspirée par une certaine idée centrale. On pense alors notamment à l’alliance. Tant que les relations humaines reflètent l’amour et la fidélité de l’alliance, ce que l’on met dans ces relations peut varier. Mais dès qu’on applique cela à l’homosexualité, l’alliance est coupée de la création. D’autres choisissent comme idée centrale l’amour en lui-même. L’amour n’a-t-il pas pour but que l’autre puisse s’épanouir ? Dans ce contexte, il faut remarquer que d’un point de vue biblique, l’amour n’est pas le remplacement mais l’accomplissement de la loi. Cela vaut aussi là où l’amour est devenu le critère principal pour juger la manière de vivre d’une autre personne. L’amour ne peut pas être invoqué comme prétexte d’une tolérance qui n’est pas en harmonie avec l’ensemble de la Bible. Comparer cela à l’autorisation donnée par Moïse d’une lettre de divorce ne tient pas debout. Parfois, on se sert de la ‘liberté’ comme idée centrale. Nous voyons dans la Bible progressivement plus de liberté pour ceux et celles qui se trouvent dans des situations de soumission : les femmes et les esclaves par exemple. L’Évangile ne voudrait-il pas apporter la liberté aux personnes ayant une orientation homosexuelle ? C’est certainement vrai, mais la liberté biblique n’est jamais en opposition à ce que Dieu a ordonné comme modèle pour la société humaine. En ce qui concerne la relation homosexuelle, la Bible ne laisse entrevoir aucun développement vers plus de liberté. La validité des commandements de l’Ancien Testament mérite une attention particulière. Les deux Testaments nous disent que le même Dieu agit de la même façon en vue du salut. Les commandements de Dieu servent de cadre à la liberté que Dieu donne à son peuple. Le fait que Christ a accompli la loi de Dieu signifie que nous ne suivons plus un certain nombre de commandements de l’Ancien Testament. Cependant, d’autres commandements sont rendus plus stricts. Les apôtres aussi continuent de prendre toutes les Écritures comment point de départ. Ainsi, Paul peut s’appuyer avec assurance sur le livre du Lévitique. Dans la Bible, à côté de l’unité, il y a aussi la diversité. Pour la validité des commandements, il est important de savoir si ceux-ci sont destinés au culte d’Israël ou pour la société civile. Le culte d’Israël a été accompli en Christ. Le fait qu’il a porté le châtiment jette une toute autre lumière sur le châtiment de l’Ancien Testament pour des péchés concrets. Bien que tous les commandements ne soient pas exclusivement à caractère moral, ils ont néanmoins tous une dimension morale, dans la mesure où ils servent à l’avancement et à la protection de l’individu et de la société devant Dieu. Cette dimension morale n’est pas toujours visible du premier coup d’œil. L’interdiction d’actes homosexuels a plus qu’une dimension cultuelle. Le fait qu’elle n’apparaisse explicitement qu’une seule fois dans le texte en confirme la force indiscutable et le rôle central. Par ailleurs, cette interdiction réapparait dans le Nouveau Testament. Certains interdits dans le Nouveau Testament semblent avoir une validité provisoire, comme par exemple l’interdiction de manger du sang. Par analogie, certains suggèrent une validité limitée de l’interdiction de relations homosexuelles. Une telle interdiction ne conviendrait que dans une culture où l’individualité est entièrement subordonnée au collectif. Dans le Nouveau Testament, la personne dans son individualité est plus en évidence. Mais cette personne est aussi appelée à une sanctification durable. Cela a un poids bien plus important dans le cadre de l’évaluation biblique de l’homosexualité que celui de la collectivité. L’idée de l’adaptation n’offre pas davantage de possibilités. Afin de faire adopter sa Parole dans la culture dominante, Dieu aurait commencé par tolérer la polygamie et le patriarcat. Pour la même raison, Paul aurait refusé les relations homosexuelles en son temps, tandis qu’à notre époque, l’autorisation de celles-ci serait justement bénéfique à la propagation de l’Évangile. Mais Paul n’écrit pas en fonction de la culture, il le fait sur base de la création, du péché originel et de la rédemption. Sur base des textes et de leur analyse, la conclusion inévitable est que les Écritures ne laissent de place ni pour un comportement, ni pour des relations homosexuels.
H L’Église et ses membres
L’Église dans son ensemble cherche son chemin en pesant le pour et le contre des choses, mais en ce processus, quelle est l’autorité de l’évaluation personnelle du membre de l’Église ? Dans l’Église, c’est la Parole de Dieu et non la culture dominante qui détermine notre style de vie. Tout membre d’église est redevable devant cette Parole. L’Esprit-Saint conduit le croyant à la vérité, y compris à ce qui est vrai sur le plan éthique. L’Esprit-Saint nous conduit ainsi en totale harmonie avec Christ, qui était entièrement soumis à la volonté de son Père céleste. C’est ainsi que l’homme trouve sa véritable identité L’homme séculier ne voit pas comment l’interdiction d’une relation homosexuelle peut être bénéfique à la condition humaine. Cela peut aussi être difficile à saisir pour les chrétiens, mais même là où nous comprenons mal le but précis de l’enseignement biblique, demeure l’appel à l’obéissance. L’Église a donc maintenu cet interdit au fil des siècles. Dans ce contexte, des péchés ont été commis. L’interdit a été appliqué de manière impitoyable et cruelle. À ce sujet, il nous faut plaider coupable. Mais condamner une mauvaise approche n’est pas du tout la même chose que s’écarter du bon commandement. Même si la punition reliée à l’interdit n’est pas adoptée, l’interdit, lui, demeure. Il peut arriver que des membres d’église fidèles et compatissants arrivent à d’autres conclusions au sujet de leur homosexualité. En soi, chaque croyant est directement responsable devant Dieu. Mais en tant que membre d’église, on s’est placé sous la supervision pastorale et la discipline du conseil d’église. Cette soumission volontaire repose sur ce que la Bible dit au sujet de la place des responsables. Les anciens expriment ce que la communion des saints a compris de la volonté de Dieu dans les Écritures. Ceci permet aux anciens de juger ce qui est contraire à l’honneur de Dieu et à la sainteté de l’église. Cette autorité dans l’interprétation des Écritures pèse plus lourd que celle du croyant individuel. Il y a des questions qui dépassent la capacité d’un conseil d’église locale. Appeler la dénomination à l’aide peut être vraiment bénéfique dans ce cas. Cela implique que, exception faite du droit de faire appel, on respecte intégralement les conclusions communes. En plus de cela, il n’est pas acceptable qu’un frère ou une sœur homosexuels soient confrontés à une ligne de conduite pastorale totalement différente lorsqu’il ou elle rejoignent une autre église locale. Un membre d’église qui malgré tout veut suivre sa propre voie devra être repris avec rigueur et amour, en toute sagesse et sensibilité.
J. Conclusion
Sur base de ce qui a été dit ci-dessus, le Synode Fédéral est arrivé à la conclusion suivante.
1. Nous reconnaissons qu’il y a parfois eu, par le passé, un manque d’attention spécifique dans le discours pastoral et dans l’action qui en découle par rapport à l’homosexualité et aux relations homosexuelles.
2. Les membres d’église qui luttent avec une orientation homosexuelle ont au sein de l’église une même position que les autres chrétiens. Leur orientation sexuelle n’y change rien. Ils sont membres d’église au même titre que d’autres, ont droit au même intérêt mutuel et ont les mêmes responsabilités dans le développement général de l’église selon leurs propres dons.
3. Les rapports sexuels entre personnes du même sexe et toute relation dans laquelle ces rapports prennent forme ne sont pas en accord avec la Parole de Dieu et doivent dès lors être nommés péchés. Dans ce cas, l’église, dans sa responsabilité pastorale, doit suivre la voie d’une mise en garde, en accord avec les Écritures et la confession de foi, et selon les règles de la discipline en vigueur.
4. L’application de ce discours biblique vis-à-vis de l’homosexualité et des relations homosexuelles dans la prédication, l’enseignement et le ministère pastoral doit se faire selon l’attitude du Christ.
II La pastorale des personnes homosexuelles
Comme tout chrétien, la personne homosexuelle qui s’engage avec le Christ est appelée à changer, à évoluer dans sa relation avec Dieu vers une manifestation toujours plus claire de la sanctification dans ses aspirations, dans ses paroles et dans ses comportements. En conformité avec l’enseignement biblique, un tel changement représente la clef du bonheur pour le chrétien. Cette affirmation est importante dans le contexte contemporain qui affirme de manière erronée que le bonheur passe inéluctablement par une pratique sexuelle conforme à l’orientation de l’individu. Un enseignement biblique clair pose d’autres jalons pour une vie chrétienne : c’est par l’obéissance aux commandements divins exprimés dans la Bible que le chrétien peut cheminer vers l’épanouissement. Certes, cet épanouissement ne comprendra certainement pas l’assouvissement de tous ses désirs (qu’ils relèvent de la sexualité, des biens matériels, des relations familiales ou des réalisations professionnelles, etc.). Il consistera plutôt en une saine et sainte gestion des manques et des désirs inassouvis, dans un contexte de reconnaissance et de jouissance pour les plaisirs néanmoins nombreux que Dieu accorde à ses enfants.
A Accompagner la personne homosexuelle, ne pas la manipuler
Une pastorale efficace consistera donc à accompagner les personnes homosexuelles dans une démarche, dont elles restent toujours responsables devant Dieu, correspondant à ce modèle biblique. Cette pastorale doit être principalement réactive, c’est-à-dire qu’elle doit être la conséquence d’une demande formulée par la personne homosexuelle. Le renoncement à son activité sexuelle pour un homosexuel ne peut provenir que d’une libre réponse, par amour pour le Christ, à son appel à prendre sa croix. La seule pastorale efficace dans ce domaine sera celle qui répond à une demande exprimée par la personne homosexuelle convaincue de la pertinence de ces sacrifices dans le contexte d’une relation d’amour avec le Christ. Cette approche nécessite une parole claire qui va à l’encontre du discours prôné par les lobbys gay : l’orientation homosexuelle n’est pas forcément inéluctable, et la personne qui admet son orientation sexuelle n’est pas obligée de pratiquer sa sexualité pour vivre une vie épanouie. Il demeure néanmoins essentiel d’aborder le cheminement de la personne homosexuelle avec beaucoup de sensibilité, car l’objectif qu’une telle personne se fixe (et qui correspond à l’exigence du Seigneur dans la Bible) est un objectif de changement de son « être », pas juste de son « faire ». L’orientation homosexuelle touche tous les domaines de la vie d’une personne, et ne peut donc pas être traitée comme un comportement auquel il suffit de renoncer une fois pour toutes. L’accompagnement pastoral dans ce domaine doit tenir compte de la souffrance de l’individu et ne pas se satisfaire d’une simple exigence comportementale. L’objectif de la pastorale de l’homosexualité est d’abord d’accompagner la personne concernée sur le chemin de la foi en Christ, et non pas de la transformer en personne hétérosexuelle, ni de lui trouver une conjointe ou un conjoint. Ce genre d’objectif (la conjugalité hétérosexuelle) cherche plutôt à rassurer l’entourage qu’à ouvrir la personne ellemême au bonheur d’une vie accomplie en Dieu, et conduit presque toujours à de graves détresses relationnelles. Compte tenu de la diversité des homosexualités, une approche pastorale judicieuse devra chercher, à la demande de la personne homosexuelle, à l’aider dans son exploration des diverses pistes qui pourraient s’ouvrir à elle et qui seraient compatibles avec une éthique chrétienne bibliquement fondée. Parmi les pistes envisageables figurent les suivantes, chacune nécessitant pour le chrétien, l’intervention, l’aide et le discernement de Dieu, et certaines pouvant bénéficier d’un accompagnement spécialisé.
1. Privilégier les penchants hétérosexuels éventuels et chercher la réalisation de la sexualité dans une conjugalité légitime. En effet, plusieurs études psychosociologiques affirment qu’homosexualité et hétérosexualité ne sont pas des orientations sexuelles exclusives et constitueraient plutôt deux pôles d’un continuum. Un grand nombre de personnes homosexuelles ne le sont donc pas exclusivement.
2. Trouver un accompagnement psychologique professionnel qui rechercherait les causes éventuelles de l’homosexualité et, le cas échéant, tenterait d’y remédier (tous les psychologues n’acceptent pas, bien entendu, de travailler dans cette perspective).
3. Demander à Dieu, et attendre de Lui, une intervention miraculeuse de restauration de la sexualité.
4. Demander à Dieu, et attendre de Lui, un don de patience, d’obéissance et de maîtrise de soi dans la perspective d’une abstinence sexuelle qui peut être temporaire (en attendant une modification de l’orientation sexuelle) ou durable (allant dans certains cas jusqu’au vœu de chasteté). Quand une personne homosexuelle sollicite un accompagnement pastoral pour vivre conformément à un tel choix, elle doit pouvoir trouver écoute et soutien auprès de l’église et de ses responsables.
B Le rôle de l’église locale dans la pastorale de la personne homosexuelle
Parmi les facteurs qui peuvent aider une personne homosexuelle à cheminer en tant que chrétienne figure le rôle important des autres chrétiens, décrits dans la Bible comme une famille spirituelle (Éphésiens 2.19) Ce rôle trouve généralement son expression la plus concrète dans la participation à la vie d’une église locale. Il ne faut pas sous-estimer ce rôle, ni le surestimer.
Ce rôle risque d’être sous-estimé si une église ne mesure pas sa responsabilité d’accueil ou si elle rejette la personne en raison de son orientation homosexuelle. Comme tout être humain qui sentirait son besoin de Dieu et rechercherait les réponses à ses interrogations spirituelles, une personne homosexuelle devrait pouvoir trouver auprès d’une église un lieu d’accompagnement et d’écoute. La communauté des chrétiens est un des outils que Dieu veut utiliser pour contribuer à la guérison des blessures relationnelles et émotionnelles de ses enfants, au soulagement de la solitude des personnes esseulées et aux besoins d’accompagnement spirituel et pastoral de chacun. La communauté spirituelle de l’église est aussi le contexte voulu par Dieu pour réorienter notre focalisation identitaire sur le Christ. Dans une société préoccupée par le narcissisme, le culte de l’image, la consommation et l’épanouissement individuel, une composante essentielle du cheminement du chrétien est le recentrage de notre identité sur le Christ. L’église est un cadre privilégié pour ce processus de croissance spirituelle, dont l’enjeu n’est rien de moins que le bonheur de chaque être humain, quelle que soit son orientation sexuelle.
Le rôle d’une église locale risque d’être surestimé si elle pense qu’elle pourrait ou devrait combler tous les manques chez la personne homosexuelle. En effet, il est légitime de chercher hors de l’église locale certaines formes de soutien comme les amitiés, l’accompagnement de relation d’aide, l’apport d’un psychologue, etc. Toutes les églises n’ont pas les moyens humains de satisfaire tous ces besoins chez tous les chrétiens, et il serait néfaste pour un pasteur (ou autre responsable d’église) de s’attendre à maîtriser tout l’accompagnement spirituel et émotionnel d’un chrétien homosexuel, comme de tout autre chrétien, d’ailleurs. Dans ce but, il peut donc être très utile pour les responsables d’une église locale d’établir des liens de confiance avec divers partenaires (responsables d’autres églises, professionnels formés en relation d’aide ou psychothérapie, etc.). Il arrive souvent que le rôle de l’église locale ne se limite pas à l’accompagnement des personnes homosexuelles, mais concerne également leurs proches, notamment leurs parents et leur fratrie. En effet, l’orientation homosexuelle concerne autant les familles dans l’église que celles qui sont extérieures à l’église. Dans le cas des parents chrétiens qui découvrent l’homosexualité d’un de leurs enfants adolescent ou adulte, il importe de proposer aux parents (mais aussi aux autres membres de la famille) un accompagnement spirituel et pastoral qui soulage leur détresse éventuelle quant aux choix de vie de leur enfant. L’église ne peut pas aider une personne homosexuelle qui ne le désire pas, même à la demande de ses parents. Par contre, elle peut proposer écoute, réconfort et accompagnement aux parents eux-mêmes.
C. Distinguer accompagnement pastoral et œuvre de l’Esprit
Le chrétien d’orientation homosexuelle est appelé, comme tout chrétien, à grandir à la ressemblance du Christ (Éphésiens 4.13-16). Ce processus est avant tout l’œuvre de Dieu Lui-même, par l’action du Saint-Esprit, et nécessite un engagement volontaire de l’individu, motivé par sa relation avec le Seigneur. L’aspiration du chrétien à se laisser ainsi changer par Dieu ne peut pas provenir d’une imposition légaliste, d’une pression ecclésiale ou d’un désir d’émulation du pasteur ou d’un autre chrétien, mais doit trouver sa source dans l’amour du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Aucun accompagnement de la part d’un pasteur ou d’une église ne peut aboutir à un résultat durable et épanouissant dans la vie d’un chrétien d’orientation homosexuelle à moins que ce dernier soit d’abord convaincu de l’amour de Dieu pour lui et sûr de son désir de vivre en disciple du Christ. Seule cette relation intime et personnelle entre l’individu et le Christ peut conduire à une vie chrétienne heureuse et spirituellement mûre.
D. Quelques interrogations pratiques et pistes de réponse
Dans la pratique, la pastorale de l’homosexualité variera énormément selon les individus et les circonstances réelles. Aucune approche théorique, comme celle que nous proposons dans ce document, ne peut espérer proposer des solutions pastorales à la multitude des cas de figure qui se présentent et qui ne manqueront pas d’apparaître dans nos églises dans les années qui viennent. Mais dans tous les cas, il conviendra de distinguer entre :
- l’accueil de la personne,
- l’acceptation ou l’accompagnement de la personne,
- et l’approbation de ses comportements.
Il est possible de proposer une écoute et un accompagnement de la personne homosexuelle qui cherche des réponses à ses interrogations spirituelles, sans pour autant approuver ses comportements. Et l’expression de cette désapprobation ne sera pas prioritaire – elle peut attendre un moment opportun quand la relation sera déjà établie, à l’image de l’approche de Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits (Jean 4). Cette distinction entre l’accueil, l’acceptation et l’approbation permet de formuler une approche qui ne rejette pas d’emblée la personne homosexuelle qui demande à devenir membre d’une église, par exemple. De même, cette distinction permettra éventuellement à un pasteur sollicité en vue de la bénédiction d’une union homosexuelle de réagir autrement que par un rejet immédiat des personnes, même s’il ne s’agit pas de donner suite à la demande de bénédiction. Celle-ci peut en effet provenir du désir de légitimer « religieusement » leur demande d’union civile, mais elle peut aussi provenir d’une réelle recherche spirituelle et d’un désir de se rapprocher de Dieu, auquel cas, une église ou un pasteur sollicités se devront d’être ouverts au dialogue. De même, dans la situation d’un couple homosexuel avec des enfants qui se mettrait à fréquenter une église, il ne sera pas forcément dans l’intérêt de tous, notamment des enfants, d’exiger une séparation des « parents » homosexuels concernés. Une approche pastorale empreinte de grâce voudra chercher à construire des relations qui ouvrent à l’Évangile, tout en affirmant clairement la vérité biblique sur les comportements et en veillant à la sérénité de la communauté. En bref, l’essentiel n’est pas que les homosexuels se mettent à vivre comme des hétérosexuels, mais que chacun se tourne en vérité vers Dieu.
III Une remarque finale en vue de préserver l’unité des chrétiens
La complexité de la pastorale de la sexualité, notamment de l’homosexualité, est telle qu’un consensus dans tous les cas de figure est impossible. Toutes les églises et tous les pasteurs, même au sein des dénominations qui se disent évangéliques (ou « représentées par les auteurs de ce document »), n’aboutiront pas aux mêmes conclusions concernant ces situations. La question de l’homosexualité divise aujourd’hui : il nous semble que deux attitudes extrêmes sont à exclure, celles des églises qui rejettent sans autres considérations les personnes homosexuelles et celles qui bénissent leur union. Pourtant, entre ces deux extrêmes, le texte présenté cidessus propose qu’il existe dans l’Église un espace pour l’accueil et l’accompagnement des personnes homosexuelles. Dans cet espace il nous faut nous accorder réciproquement, entre chrétiens et responsables d’églises, le « droit » de parvenir à des conclusions et des lignes d’action parfois différentes les unes des autres, du moment qu’elles ne franchissent pas la double frontière biblique du rejet de la personne homosexuelle et de l’acceptation de la pratique homosexuelle, mais qu’elles s’inscrivent dans un véritable amour du prochain homosexuel. Il en va de la légitimité de notre témoignage chrétien et de la visibilité lumineuse du message de l’Évangile dans l’obscurité du monde où nous vivons.