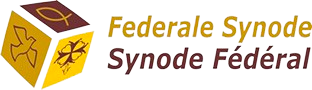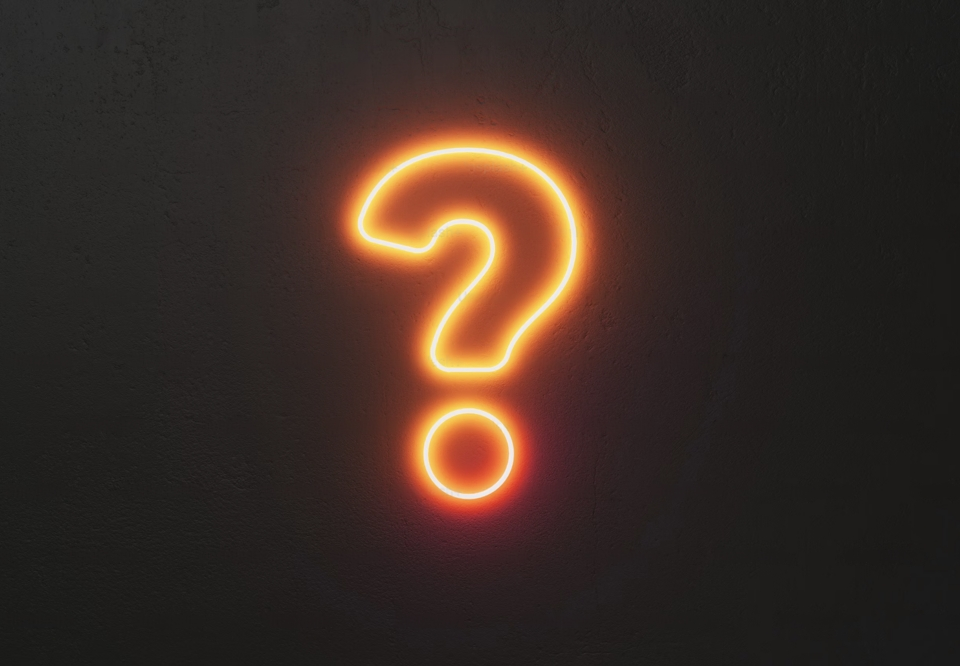Une éducation chrétienne(AS 24/11/2018)
24 novembre 2018
Appel à l’occasion du scrutin(26/05/2019)
26 mai 2019Téléchargez le texte officiel à ce sujet
Ce texte constitue une réponse aux questions du Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog [en français : Dialogue interconvictionnel flamand] posées aux différentes convictions. Merci à Ignace Demaerel.
1. Qu’est-ce-qui motive notre engagement envers les gens nécessiteux ?
L’attention pour les pauvres est un thème important pour un chrétien, qu’il soit catholique, protestant ou évangélique, ou encore d’une autre église. Pour lui, c’est même une mission de Dieu, qu’on retrouve aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu Lui-même est le défenseur des faibles, des orphelins et des veuves (Psaumes 68:6). « Exploiter le faible, c’est insulter son Créateur, mais faire grâce au pauvre, c’est L’honorer » (Proverbes 14:31). Et dans le Nouveau Testament, Jésus S’identifie aussi avec les faibles : « Ce que vous (n’)avez (pas) fait aux plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous (ne) l’avez (pas) fait » (Matthieu 25:40,45), en référence aux “six œuvres de miséricorde” . Avoir soin des plus faibles n’est pas optionnel mais bien une mission qui s’impose à nous.
Dans l’attention pour les pauvres, une dimension supplémentaire s’ajoute pour un chrétien croyant : lorsque Dieu entre en jeu, cette mission s’approfondit et acquiert un caractère plus impératif sur quatre domaines. (1) L’image judéo-chrétienne de l’être humain en arrière-plan y fait déjà fortement appel. Le pauvre est créé par Dieu semblable à son image, et sa dignité humaine n’en est pas moindre que quelqu’un “qui a réussi”. Il n’y a pas de “sort” ou de “karma” par lequel il devrait être irrémédiablement pauvre et piétiné. Abuser de la faiblesse du pauvre est un grave péché. La charité ne peut dès lors jamais être condescendante. (2) La mission vient de Dieu Lui-même et ne peut pas être niée impunément. Ce n’est pas une règle humaine mais un commandement qui vient d’en haut. Comment on se comporte envers notre congénère pauvre révèle comment on se comporte envers Dieu. (3) La motivation doit aussi aller plus loin : il ne faut pas donner une pièce ou un billet “pour en être quitte” , “accomplir son devoir”. Si quelqu’un le fait sans amour, pour Dieu cela n’a en fait aucune valeur (selon l’ode à l’amour dans 1 Corinthiens 13:3). De même, si on donne l’aumône pour impressionner les gens, c’est complètement inutile (Matthieu 6:1-4). Une vraie aide signifie de nous donner nous-même. (4) L’aide ne peut pas être limitée à la seule aide matérielle. La pauvreté matérielle n’est pas la pire : il y a aussi de la pauvreté émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Les causes de la pauvreté matérielle se trouvent en général à un niveau plus profond. L’être humain n’est pas seulement corps et âme, mais aussi esprit. L’être humain qui est “déconnecté” de Dieu, se retrouve aliéné de son “véritable moi”, tombe dans toutes sortes de dépendances, déraille. Donner à manger, un abri et des vêtements est l’étape numéro un. Cela est même humiliant pour un être humain dans le besoin que quelqu’un n’ait que de l’argent à lui offrir. Aider le pauvre à se tenir de nouveau debout, lui redonner sa (sensation de) dignité, est l’approche holistique et personnalisée qui produit un effet durable. C’est pourquoi, pour un chrétien, l’assistance est liée intrinsèquement au partage de la “Bonne nouvelle”, sans imposer cette dernière ni la poser comme condition.
2. À quel point l’existence de la pauvreté est-elle acceptable ?
Dans ce monde, il y aura toujours des pauvres et des riches, déjà rien que par les différences de talents, de force de travail et d’engagement. Mais il y a aussi beaucoup d’autres facteurs qui se situent en dehors des choix ou possibilités personnel(le)s. La pauvreté est inacceptable lorsqu’elle est dramatique et menace la vie, car la vie et la dignité humaine sont alors compromises. Mais aussi lorsqu’elle est causée par de l’injustice, par un abus conscient et de l’exploitation, que cela soit par des individus ou par des structures “légales” injustes. Il n’y a, en soi, rien de mal lorsque certaines personnes deviennent (très) riches : cela peut être un magnifique instrument pour elles pour faire beaucoup de bien.
3. Quelle est la place et la fonction de l’empathie, de l’émancipation et de la diversité au sein de notre vision ? Comment cette vision peut-elle se traduire en action pratique à l’égard de personnes dans la pauvreté qui peuvent ne pas faire appel à nous ?
L’aide est la meilleure lorsqu’elle est personnelle et vécue. Veiller volontairement et spontanément sur nos congénères parle toujours plus fort que le “professionnel” qui le fait car il est payé pour ça. Un bel idéal pour un chrétien est celui des premières églises où les croyants avaient tout en commun afin que personne parmi eux ne soit dans le besoin (Actes 2:45; 3:32-37): le partage se faisait spontanément, avec son cœur et redonnait au pauvre une communauté à laquelle il appartenait. L’aide professionnelle aussi sera certainement nécessaire là où se forment des trous dans la solidarité spontanée, mais ne peut pas remplacer cette dernière.
4. Quels éléments de la politique actuelle et dans les rapports économiques sont contraires aux principes éthiques de chacune de nos convictions et quelles alternatives avons-nous à présenter ?
Les autorités ont un rôle important à jouer en matière de lutte contre la pauvreté, puisque la pauvreté est un phénomène sociétal. Bien que nous ne puissions jamais effacer la responsabilité individuelle, il y a malgré tout trop de facteurs structurels et des modèles injustes qui créent la pauvreté et la maintiennent en place : ce n’est jamais la faute d’un seul individu. Nous n’avons pas seulement besoin de charité, mais aussi de justice et d’équité, par le moyen d’une approche structurelle et d’ajustement constant de la législation, par exemple par des mécanismes de redistribution. Mais vu que les autorités doivent rester neutres et ne peuvent que se limiter à de l’aide générale et matérielle, leur rôle reste limité. Des organisations à caractère religieux semblent mieux prester sur le terrain que des organisations neutres. Les “soins neutres” n’ont pas de visage. Des églises peuvent apporter un point d’ancrage spirituel, une communauté, un nouvel espoir et une foi aux personnes qui ont touché le fond du gouffre. Elles peuvent aussi mobiliser des bénévoles et créer des réseaux beaucoup plus facilement. Cela ne serait pas non plus juste si tous les citoyens faisaient porter à “l’État” le poids de la lutte contre la pauvreté et mettraient de côté leur propre responsabilité. Des autorités ne doivent donc pas organiser à elles seules la lutte contre la pauvreté, car elles sont trop éloignées des gens et fonctionnent de manière trop impersonnelle. Elles doivent plutôt créer un cadre sain et un climat pour les citoyens et organisations (la “société civile”) qui ont une passion pour le sujet afin de rendre possible cette passion. Il est plus efficace que les autorités délèguent cette charge et créent un espace financier, et respectent dans ce cadre la pluralité convictionnelle. Le soutien d’initiatives qui renforcent le tissu social – la famille en premier lieu – est probablement la meilleure mesure préventive pour tous.